![Une délégation du Conseil américain des Églises s'entretient avec des Églises néerlandaises au sujet des bombardements au Vietnam. Le professeur Harvey Cox montre une bombe à fragmentation de Honeywell. [Rob C. Croes (Anefo) /Wikimedia Commons-CC0 1.0]](/images/stories/humanisme/Delegatie_van_Amerikaanse_Raad_van_Kerken_spreekt_met_Nederlandse_Kerken_over.jpg)
Harvey Cox est un théologien et universitaire américain connu pour avoir marqué la pensée religieuse contemporaine par son regard audacieux sur la modernité, la sécularisation et le rôle des traditions spirituelles dans un monde en mutation.
Professeur emblématique de la Harvard Divinity School, il s’est imposé comme une voix majeure du dialogue interreligieux, explorant la manière dont les religions peuvent non seulement coexister, mais aussi s’enrichir mutuellement.
Parmi ses œuvres majeures, La Cité séculière, publiée en 1965, est sans doute son livre le plus connu. Harvey Cox y soutient l’idée que la modernisation n’est pas nécessairement opposée à la foi. Il prend ainsi le contrepied de l’idée dominante voulant qu’au fur et à mesure que la société devient “séculière”, c’est-à-dire émancipée des institutions religieuses, la religion tiendra de moins en moins de place dans la vie des personnes ordinaires.
Modernité, sécularisation et spiritualité
Pour Cox, la sécularisation de la société n’abolit pas le religieux, mais libère la spiritualité des cadres dogmatiques et des institutions rigides. Il voit dans le monde séculier contemporain, avec ses villes, ses luttes et ses solidarités, un espace tout aussi habité par le sacré que les temples ou les églises. Ainsi, on peut rencontrer la transcendance, le sacré, dans les lieux les plus ordinaires de la vie moderne : dans l’agitation et la diversité d’une ville, dans l’expérience de la solidarité et du soin, dans les engagements civiques et politiques qui visent à améliorer la société.
Pour lui, la « cité séculière » est un espace où les grandes questions spirituelles – sens, dignité, justice, fraternité – apparaissent, même en dehors des cadres religieux classiques.
Les spécialistes des religions évoquent la métamorphose actuelle de la religiosité par des expressions telles que “passage à la transcendance horizontale” ou “orientation vers l'immanent”. Mais il serait plus juste de la considérer comme la redécouverte du sacré dans l'immanent, du spirituel dans le profane.
Harvey Cox, The Future of Faith, HarperOne, 2009 (traduction libre).
Cox insiste aussi sur l’idée que la modernité pousse les religions à se renouveler. Elles ne peuvent plus simplement se contenter de répéter des dogmes anciens mais doivent dialoguer avec la science, les cultures diverses, la démocratie. Ce processus les oblige à retrouver leur cœur vivant : la compassion, la recherche du sens, la quête de justice. Ainsi, au lieu de voir la modernité comme une menace qui vide la religion de sa substance, Cox y voit un catalyseur qui aide la foi à sortir de ses carcans pour redevenir plus authentique, plus universelle.
Un mouvement en phase avec son temps
Ces perspectives trouvent un écho particulier avec la Soka Gakkai qui, justement, insiste sur l’importance de pratiquer dans la vie quotidienne, sur la conviction que la transformation intérieure doit s’accompagner d’un certain engagement social, et sur l'idéal d'une solidarité humanité transcendant les différences.
Dans son ouvrage The Future of Faith (2009), Cox cite explicitement la Soka Gakkai comme un exemple de mouvement religieux évoluant vers moins de hiérarchie, plus d’engagement civique (droits humains, paix, désarmement nucléaire, etc.), et plus d’ouverture à l’interconfessionnalité. Pour lui, le mouvement Soka incarne une spiritualité active, tournée vers la société, non bridée par des structures strictement religieuses.
A lire...
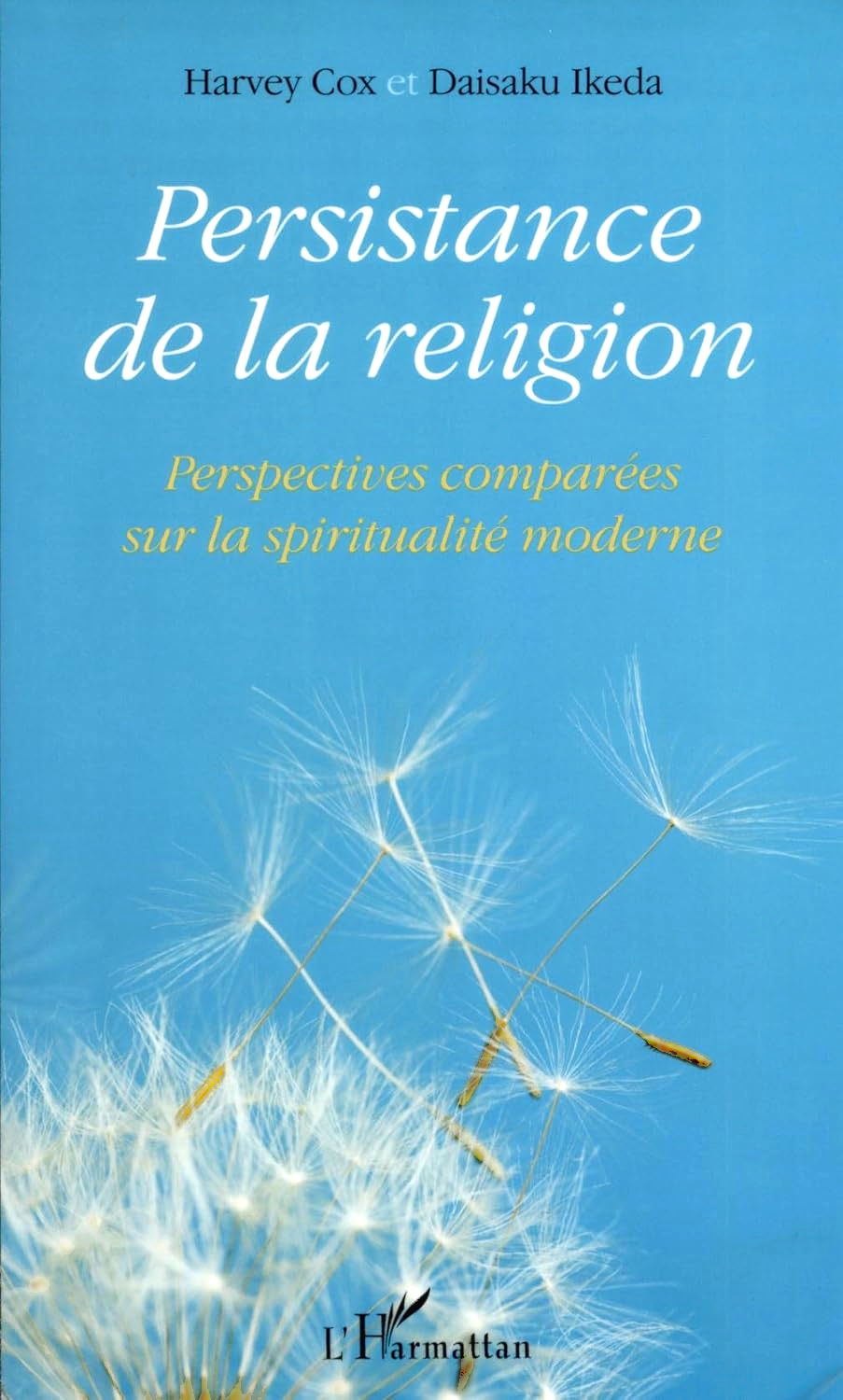
Harvey Cox a rencontré Daisaku Ikeda pour la première fois lorsque ce dernier a prononcé un discours à Harvard en 1991. Il a été par la suite membre du panel lors de la révision de la deuxième conférence de Daisaku Ikeda à Harvard, en 1993. Les deux hommes ont écrit un livre de dialogue, intitulé Persistance de la religion - Perspectives comparées sur la spiritualité moderne, explorant la persistance de la religion dans un monde moderne souvent perçu comme sécularisé.
Persistance de la religion, Harvey Cox et Daisaku Ikeda, Editions L'Harmattan, 2012. Disponible sur le site de l'éditeur
![M. Ikeda accueille le professeur Cox à l'Université Soka de Hachioji, Tokyo, mai 1992. [©Seikyo Shimbun]](/images/stories/humanisme/cox-ikeda-g.jpg)
Bio express
Harvey Gallagher Cox Jr. est né le 19 mai 1929 à Malvern (Pennsylvanie, États-Unis). Baptisé dans la tradition baptiste, il a suivi un parcours universitaire prestigieux : BA en histoire à l’Université de Pennsylvanie (1951), B.D. à Yale Divinity School (1955), puis un Ph.D. en histoire et philosophie de la religion à Harvard (1963).
En 1957, il est ordonné ministre baptiste. Il enseigne d’abord à Andover Newton Theological School, puis rejoint la Harvard Divinity School en 1965, devenant professeur titulaire en 1969. Il prend sa retraite en 2009.
